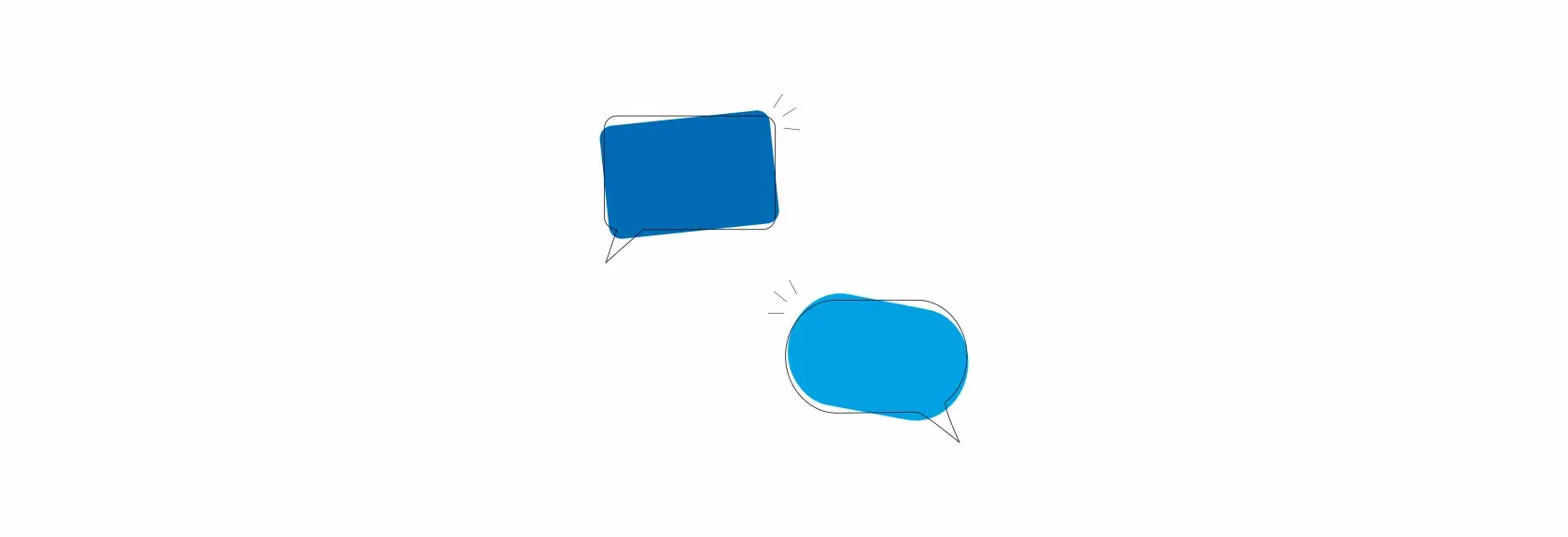
La philosophie en débat(s): une histoire de la philosophie analytique
Séminaire de recherche franco-canadien organisé par :
Iris Brouillaud (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Juliette Courtillé (Sorbonne Université)
Raphaël Tossings (Sorbonne Université/Université d’Ottawa)
Samuel Vitel (Université de Poitiers/Université d’Ottawa)
À rebours d’une dichotomie méthodologique - encore trop souvent tenue pour évidente -entre l’histoire continentale de la philosophie et sa pratique analytique, originaire du monde anglo-saxon, il nous semble judicieux d’adopter un point de vue historique sur la philosophie analytique.
L’originalité de ce séminaire réside dans l’insistance sur la dimension « conversationnelle » de la philosophie, un adjectif que Richard Rorty a justement utilisé pour critiquer le manque de conscience historique des philosophes analytiques en indiquant préférer « les philosophes qui sont suffisamment historicistes pour penser à eux-mêmes comme prenant part à une conversation plutôt que comme pratiquant une discipline quasi-scientifique » (2007 : 126).
La philosophie analytique est pour autant caractérisée par une dimension conversationnelle certaine en ce que plus sans doute qu’ailleurs, l’élaboration et le développement de la pensée des philosophes naît de la pratique du jeu public des objections et des réponses avec d’autres philosophes. L’histoire de la philosophie analytique se comprend ainsi mieux à la lumière des conversations qui ont animé ses représentants.
C’est cette pratique conversationnelle de la philosophie – dans sa double dimension dialogique et historique, dans ses implications philosophiques et métaphilosophiques - que le séminaire se donne pour objectif d’explorer. Chaque séance s’appuiera sur un dialogue précis entre deux ou trois philosophes, où sera recontextualisé et examiné un échange réciproque et soutenu de thèses, d’objections et de réponses, dans des extraits de livres et/ou des articles. Les textes sur lesquels portent les interventions pourront être envoyés en amont de chaque séance. Les interventions seront suivies d’une discussion. Tous les publics sont bienvenus.
PROGRAMME
Mercredi 19 novembre (17h30-19h CET, Ottawa) : David Bakhurst (Queen’s University) : « Anscombe versus Austin » - séance en distanciel
Mercredi 10 décembre (17h30-19h, salle Cavaillès) : Loïc Doroteo (Nantes Université) : « Le compatibilisme peut-il résister aux arguments de la manipulation ? »
Mercredi 31 janvier (17h30-19h CET, Ottawa) : Ryan Simonelli (Wuhan University), « Immodest ambitions: Dummett, McDowell and Brandom on the promise of semantics - séance en distanciel
Mercredi 11 février (17h30-19h, Paris, salle à confirmer) : Jeanne-Marie Roux (UCLouvain Saint-Louis), « Y a-t-il quelque chose qui est vrai ? Le débat entre Austin et Strawson »
Mercredi 8 avril (17h30-19h, Paris, salle à confirmer) : Arnaud Petit (University of Oxford), Présentation de Having meanings in view.
Mercredi 20 mai (17h30-19h, Paris, salle à confirmer) : Grégoire Lefftz, « La conceptualité de l’expérience : McDowell, Dreyfus et Taylor "
Pour chaque séance, un lien zoom est disponible sur demande
Contacts:
Paris 1 : iris.brouillaud@univ-paris1.fr
Sorbonne Université : juliette.courtille@sorbonne-universite.fr
Ottawa : samuel.vitel@univ-poitiers.fr