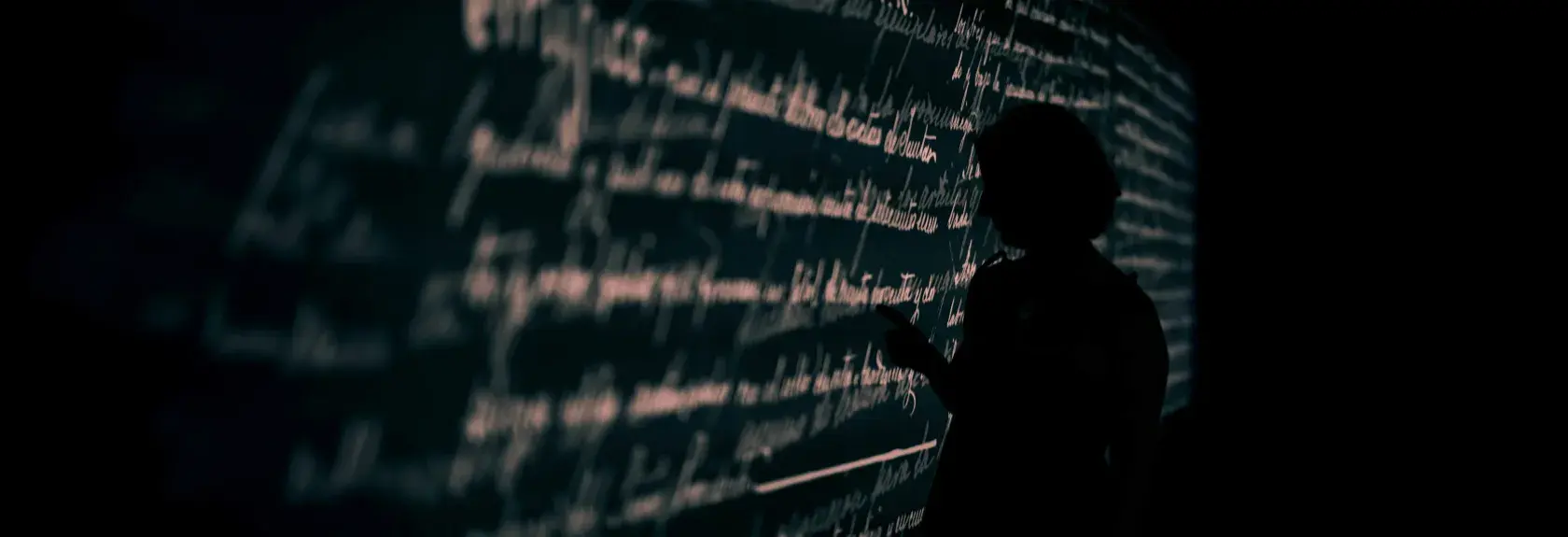
L’origine du langage : les apports de l’anthropologie philosophique
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103)
PhiCo-EXeCO
Organisation Étienne Bimbenet
Voici une trentaine d’années que la psychologie évolutionniste remet à l’honneur une vieille question philosophique : celle de l’origine du langage. L’invention de symboles conventionnels, et non simplement indexicaux ou iconiques ; ou d’une communication « détachée » ou « déplacée », référée à des objets non-immédiatement présents ; ou d’un langage « prédicatif » et syntaxiquement articulé, capable de varier indéfiniment le sujet dont on parle, comme les prédicats qui leur sont attribués ; cette invention d’un langage finalement propre à sapiens pose de nombreuses questions. Elle aura stimulé, en particulier, une certaine imagination narrative, articulée à différents scénarios possibles. Certains parient sur l’idée d’une complexification progressive des systèmes de communication, culminant dans l’apparition d’un langage syntaxique ou « chomskien ». D’autres imaginent plutôt un scénario en deux étapes, avec l’acquisition préalable d’un langage soit « proto-prédicatif » (Derek Bickerton), soit « holistique » (Ray Jackendoff), soit gestural et mimétique (Merlin Donald, Kim Sterelny), soit vocal et émotionnel (Alison Wray, Steven Mythen), soit symbolique et conventionnel (Terence Deacon, Christopher Henshilwood).
C’est dire que les points d’interrogation sont nombreux et qu’est bienvenue du coup, sur un tel sujet, la synergie de compétences venue conjointement de la biologie de l’évolution, de la génétique, de la linguistique ou de l’anatomie paléoanthropologique. Mais les ressources théoriques pourraient venir, aussi bien, de l’anthropologie philosophique. Entendons par là, en un sens large, ce mouvement de pensée qui au 20ème siècle, voulut délibérément reconstruire une image de l’humain sur le sol de son origine animale. Scheler, Plessner, Gehlen, et jusqu’à Blumenberg, mais également Cassirer, Goldstein, Buytendijk, Merleau-Ponty ou Tran Duc Thao : tous, même si ce fut par des voies fort différentes, furent confrontés à la tâche de repenser l’humain sur le fond de son histoire naturelle. Ce faisant ils rencontrèrent, comme une donnée centrale de leur discours, la question de l’origine du langage.
Un élément commun se dégage de l’ensemble de ces discours, sur lequel nous aimerions faire le point. Une ambition puissamment synthétique anime ces différentes pensées. C’est pourquoi, aussi différentes soient les conceptions du langage qu’elles défendent, c’est à chaque fois à un fait total que nous avons affaire. Pour l’ensemble de ces penseurs le langage est une fonction générale, qu’on dira « expressive » ou « symbolique » ou « catégoriale », selon les cas. Avec elle il peut être question de « mise en forme » et d’« objectivation » de l’expérience (Cassirer) ; d’« indication » et de « communautisation » du donné (Tran Duc Thao) ; de « création » puis de « sédimentation » d’un sens inédit (Merleau-Ponty ») ; de « canalisation » de l’« excédent pulsionnel » (Gehlen), ; de « mise à distance » et d’« évitement » du réel (Blumenberg), etc. Mais il est clair à chaque fois que le langage, c’est davantage que la simple performance verbale. L’apparition du langage est loin d’être un fait anodin ; avec elle c’est le tout de l’expérience qui s’en trouve transformé. C’est à cette diversité d’approches, mais aussi à cette commune ambition généralisante et philosophique, que tentera de faire droit cette journée d’études.
Programme
9h15 - Accueil des participants
9h30 - Etienne Bimbenet (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Remarques préliminaires
10h - Christian Sommer (Archives Husserl de Paris) : "Outil, langage, raison. Quelques réflexions à partir de Blumenberg, lecteur d’Alsberg"
11h – Pause
11h15 - Tudor Djamo (Archives Husserl de Paris) : "Action, délestage, symbole : pour une anthropo-biologie du langage (Arnold Gehlen)"
Pause déjeuner
14h - Didier Guimbail (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : "Pourquoi le langage est-il un fait total ? L'origine et le statut du langage chez Plessner"
15h - Matteo Pagan (université de Kassel) : "Du concret à l'abstrait: le langage chez Paul Alsberg et Dieter Claessens"
16h – Pause
16h15 - Tobias Endres (ENS/PSL - Fondation Humboldt) : "À l’origine de la conscience : le symbolisme « naturel » comme expression passive"