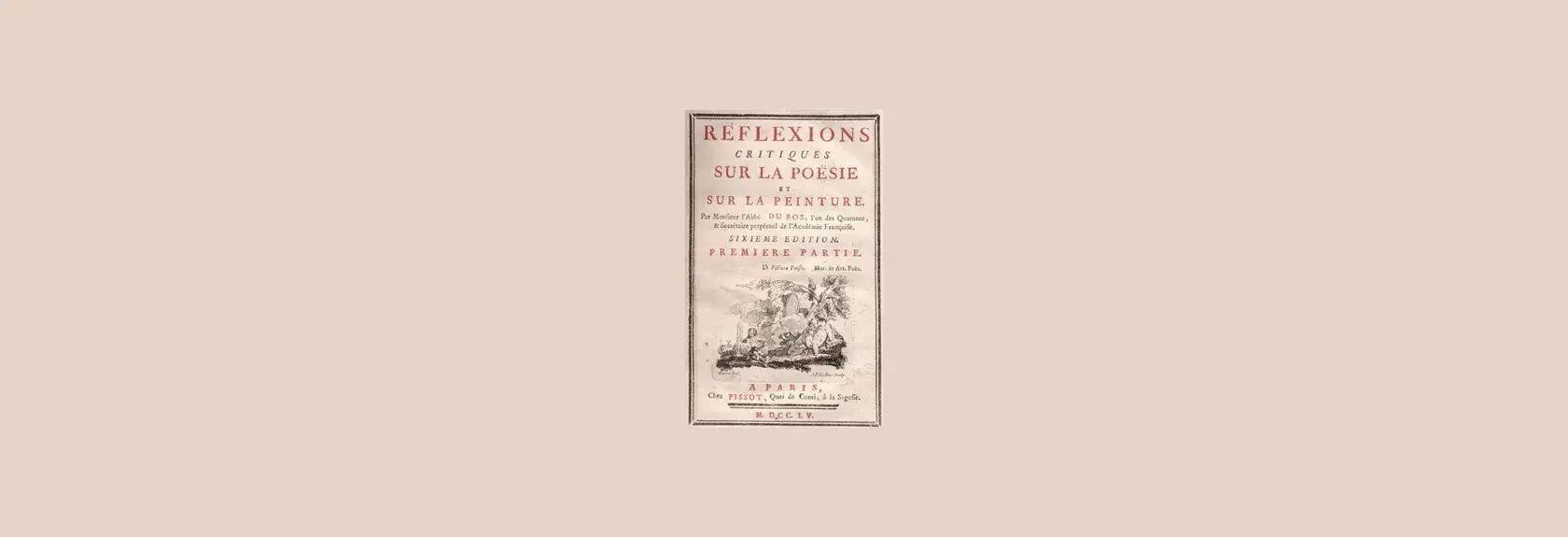
Dubos en perspective
Sources et réceptions des Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture
Colloque international
Organisé par Thibault Barrier, Daniel Dauvois et Daniel Dumouchel
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (HIPHIMO, UR 1451) et Université de Montréal Paris, les 12 et 13 décembre 2025
avec la participation des universités d'Ottawa et de Victoria
Le présent colloque vise à approfondir et à compléter les recherches sur l’un des textes fondateurs de l’esthétique philosophique moderne que sont les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture [1719] de Jean-Baptiste Dubos. Après l’analyse de divers aspects structurels des Réflexions critiques (Daniel Dauvois et Daniel Dumouchel (dir.), Vers l’esthétique, Paris, Hermann, 2015), il s’agit désormais, à l’occasion la publication en novembre d’une nouvelle édition critique de l’ouvrage, de les encadrer par l’étude de leurs sources et de leur réception.
Les sources sont fort nombreuses, parfois très fréquentes dans le corps du texte (Quintilien surtout, mais aussi Horace, Cicéron, Corneille, le chevalier Chardin, Meibomius), parfois très rares (Galilée, Descartes, Malebranche), et souvent tout-à-fait absentes (Pascal, Locke) ou plutôt plus ou moins actives quoiqu’inexplicitées. Il y a donc une difficulté de principe à bien apprécier, par exemple, l’incidence du divertissement aux sections 1 à 4 de RC I, ou bien le poids de l’empirisme de Locke sur la section 33 de RC II. Malgré les apparences et un plus grand intérêt à citer les autorités musicales, on en dira tout autant de la troisième partie, voire de toute la présence de la musique dans l’ensemble de l’ouvrage : Dubos se rapporte à peu d’œuvres musicales, il ne consacre que des remarques éparses à l’opéra, dont on est par ailleurs certain qu’il en goûtait tout particulièrement les principes esthétiques et le régime assez libre d’expression des passions divines ou trop humaines, et dont il conviendra ainsi de mesurer l’incidence normative sur les goûts diversement répandus sous ou bien parmi la doctrine. Il énonce peu sur Quinault, encore moins sur Lully, alors que la tragédie lyrique française n’a pas pu ne pas affecter en profondeur ses manières d’analyser les spectacles et les rapports qu’y venait entretenir un public, avec ou sans goût de comparaison.
Un point décisif de l’esthétique dubosienne tient enfin à la neutralisation critique de tout recours à la tradition théologique pour penser l’origine de la beauté et la légitimité d’une forme singulière de plaisir sensible. C’est à partir de ce refus de la transcendance que se constitue le domaine propre de l’esthétique, entendue comme mode de réception sensible spécifiquement engagé par la relation aux œuvres d’art. Il s’agira ainsi, à partir de cette critique esthétique de la religion, d’interroger l’éventuelle philosophie première à laquelle Dubos s’adosse, et de prendre ainsi toute la mesure du caractère « critique » des Réflexions de Dubos.
Semble alors se profiler, dans cette fonction, une sorte de philosophia perennis qui sait par exemple confondre une théorie de l’imagination venue de Quintilien avec des éléments climatiques et géographiques venus de Barclay, de Huarte, voire de Malebranche. Comment être un Ancien en philosophie et tenter de contribuer à la diffusion explicite de lumières, qui sont, il est vrai, non de la raison mais de l’expérience ? On éprouve ainsi de la difficulté à situer Dubos dans le rapport à ses sources : il semble n’être d’aucune école, et non pas même de l’école éclectique. C’est sans doute que ce que nous appelons communément source constitue plutôt pour Dubos, à chaque moment de sa mise en usage effective, une espèce d’instrument, plus ou moins destiné à monter des machines empirico-notionnelles, asservies à quelque fonction ponctuelle. Et c’est là moins du bricolage conceptuel qu’un parti fort résolu et décidé de s’opposer en tout à la systématicité, qui n’est que l’ombre impuissante de la raison.
La réception des Réflexions critiques propose d’autres énigmes à dénouer, mais qui contribuent, comme les questions portées vers les sources, à rendre malaisée l’inscription de l’ouvrage au fil de l’histoire et à interroger l’économie des effets de lecture de ce texte. Dubos commence certes par être fort lu et par diffuser et donner à discuter ses positions esthétiques un peu partout en Europe. Mais fait-il école et l’a-t-on bien lu ? On ne saurait dire que les lectures de Condillac ou de Montesquieu, il est vrai plutôt sur l’œuvre historique pour ce dernier, voire celle de Hume, ont été animées d’un solide principe de charité ; et déjà la réaction somme toute pertinente de Jean-Jacques Bel (et non pas Bayle, comme écrit G. Lanson en un sérieux moment d’inadvertance), dès 1726, aura manqué l’essentiel de la théorie du goût, qui se pouvait tirer de la seconde partie. La pensée de Dubos semble réduite à la thèse d’un sixième sens et à la section 22 de RC II, couplées à la théorie anthropologique des finalités de l’art mimétique, que développe le tout début de l’ouvrage. Sans doute est-il davantage considéré avec sérieux dans le monde germanique, voire dans l’anglo-saxon ; toutefois en France, on le cite sans distance, puis, comme de Jaucourt dans l’Encyclopédie, on le pille sans toujours le citer. Ensuite, au-delà de 1770, date de la dernière édition Pissot, plus rien : comment en comprendre l’événement ou sans doute plutôt le non-événement ? Au tome 6 du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (Paris, 1870, pp. 1316-17), Pierre Larousse se contente de rappeler, à l’entrée J.-B. Dubos, le statut de secrétaire perpétuel de l’Académie française et l’œuvre d’historien, convoquant la critique sévère de Montesquieu et la louange de Chateaubriand. Le Nouveau Larousse illustré (1897-1904) donne une version trois fois plus courte, où les Réflexions critiques sont mentionnées comme le meilleur ouvrage de l’auteur, sans qu’il en soit alors dit davantage.
Les renaissances épisodiques d’un intérêt pour les Réflexions critiques, chez Alfred Lombard, au début du siècle dernier, chez Basil Munteanu au milieu de ce dernier, chez Annie Becq ou Catherine Kintzler, à la fin du même, auront de la difficulté à susciter un intérêt durable et général pour un auteur si bien reçu et reconnu en son siècle comme un auteur indispensable à toute réflexion prochaine sur les arts. D’où peut bien venir cette allure historique défective et qu’est-ce qui en peut être responsable ? Il faudra se demander si ce sont les positions esthétiques de Dubos – lesquelles, en leur équilibre instable entre Anciens et Modernes, entre le grand goût et le plaisir d’être pris par diverses émotions, restent malaisées à bien identifier et fixer – qui sont fautives parce qu’intempestives et sans assiette, ou bien si ce sont des négligences de lecture, mais alors imputables à qui ou à quoi ? Les idées de Dubos ont-elles constitué une mode sans grand lendemain, alors qu’elles méritaient une attention moins volage, ou bien étaient-elles d’agencement trop fragile, trop métastable, pour avoir le droit de durer ?
On aura ainsi occasion de se demander ce qu’est au juste la puissance d’une doctrine, ou bien la nature de ses effets de lecture, et qu’est-ce qu’appartenir à l’histoire des idées, quelle forme d’intégration à quelle sorte de flux se trouve supposée ? Le cas de Dubos n’est-il pas un cas plus marqué et plus insistant d’un processus de défection historique, qui concerne de fait aussi bien toutes les doctrines et toutes les théories ?
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2025
9h15-9h30 Accueil des participants et introduction
Session 1 – Sources
Maison de la philosophie Marin Mersenne, 13 rue du Four, 75006
Salle 0510 – 5e étage
9h30-10h15 – Alain Petit (Université Clermont-Auvergne) : Quintilien dans les Réflexions critiques
10h15-11h – Thibault Barrier (Université Paris 1) : Ennui, règles et sentiment : Pascal dans les Réflexions critiques
11h15- 12h – Daniel Dauvois (Lakanal) : Dubos et les philosophes
12h-14h – pause
Session 2 – Opéra et musique
Centre Panthéon - Salle 1 – escalier M, 1er étage, 12 place du Panthéon, 75005
14h-14h45 – Camille Guyon-Lecoq (Université de Picardie Jules Verne) : Les Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture de Dubos : une pensée Moderne sur les arts de l'effet
14h45-15h30 – James Young (Université de Victoria) : Jean-Baptiste Dubos and the Problem of Opera
15h45-16h30 – Frédéric de Buzon (Université de Strasbourg) : Dubos et les théoriciens anciens de la musique
SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2025
Session 3 – Réceptions
Centre Panthéon - Salle 1 – escalier M, 1er étage, 12 place du Panthéon, 75005
9h30-10h15 – Mitia Rioux-Beaulne (Université d’Ottawa) : L'églogue comme lieu théorique. Dubos et Fontenelle
10h15-11h – Iris Douzant (Université Paris 1) : Hume et Dubos : sur le goût
11h15-12h00 – Alexis Tétreault (Université d’Ottawa) : Le besoin d’avoir l’esprit occupé ou les paradoxes de l’anthropologie dubosienne et de sa réception
12h -12h45 – Thierry Côté (Université de Montréal) : Rousseau lecteur des Réflexions critiques
Pause
14h30-15h15 – Daniel Dumouchel (Université de Montréal) : Dubos et Lessing
15h15-16h30 – Thomas Pavel (Université de Chicago) : Dubos et la permanence artistique [à distance]
16h45-17h45 – Table ronde « Éditer les Réflexions critiques » : James Yong (Université de Victoria), Thierry Coté (Université de Montréal), Daniel Dauvois (Lakanal)